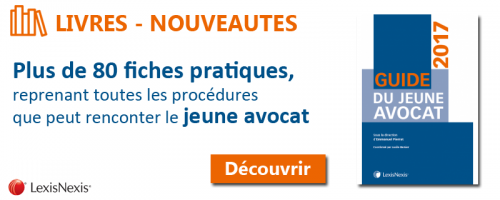
LexisNexis vous propose ci-dessous un extrait du « Guide du jeune avocat 2017 »
I – Aperçu rapide
A – Caractéristiques générales
1 La conciliation, qui tend à la recherche d’un accord entre deux parties afin de mettre fin au litige qui les oppose, est à la fois :
– un mode conventionnel de résolution des litiges encadré par le droit, peu utilisé en pratique mais qui connaît actuellement un intérêt croissant ;
– une phase préalable à certains procès :
• facultative devant certaines juridictions (ex. : tribunal d’instance [TI]),
• obligatoire devant d’autres (ex. : conseil de prud’hommes).
Le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale (D. n° 2010-1165, 1er oct. 2010), entré en vigueur le 1er décembre 2010, est venu :
– encadrer le statut des conciliateurs ;
– renforcer la conciliation devant certaines juridictions ;
– faciliter le renvoi aux fins de jugement en cas d’échec de la conciliation (« passerelle »).
Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif notamment à la résolution amiable des différends (D. n° 2015-282, 11 mars 2015), dont les dernières dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2015, est venu :
– favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges en obligeant les parties à indiquer dans l’acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées ;
– simplifier les modalités de délégation de sa mission par le juge de conciliation à un conciliateur de justice.
Il existe des règles générales relatives à la conciliation et des règles propres à la procédure préalable devant le TI.
L’articulation entre ces deux corps de règles est la suivante :
– les règles relatives au TI s’appliquent prioritairement puisque devant cette juridiction la conciliation est préalable (CPC, art. 830) ;
– les règles générales sont applicables à l’issue de la procédure de conciliation préalable et tout au long de l’instance (CPC, art. 127 à 131).
La demande de conciliation :
– est à l’initiative du demandeur devant le TI ;
– interrompt les délais (CPC, art. 830, al. 3).
En cas d’échec de la conciliation, l’instance se poursuit.
B – Conditions d’utilisation
2 La conciliation devant le TI :
– est ouverte à tous (CPC, art. 830) ;
– ne présente pas de caractère obligatoire. Avant d’assigner, le demandeur peut former une demande aux fins de tentative préalable de conciliation.
Retour d’expérience :
En pratique, il est très rare qu’une tentative de conciliation soit demandée.Le décret n° 2010-1165 précité encadre l’activité appelée à se développer des conciliateurs de justice, notamment en allégeant le formalisme de la délégation de la conciliation par le magistrat saisi (V. CPC, art. 831 et s.).
Un allègement procédural est destiné à rendre plus attractive la tentative préalable de conciliation.
C – Avis du professionnel
3 La conciliation préalable devant le TI est rarement sollicitée par le demandeur alors qu’une telle demande pourrait permettre éventuellement de régler rapidement des petits litiges et de désengorger la juridiction.
Faire le point avec le client pour savoir s’il est judicieux de tenter une conciliation ou si le dossier nécessite une action en justice.
D – Textes
- CPC, art. 21.
- CPC, art. 84.
- CPC, art. 127 à 131.
- CPC, art. 830 à 836.
- CPC, art. 842.
- CPC, art. 845.
E – Schéma procédural
1 – Tentative préalable devant le tribunal d’instance
4 • Introduction de la demande de conciliation du demandeur par déclaration faite, remise ou adressée au greffe (CPC, art. 830).
• Conciliation menée par le juge du TI ou déléguée à un conciliateur de justice (CPC, art. 831 et 845).
• Le demandeur, le défendeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge.
• Fixation de la durée de la mission du conciliateur par le juge (maximum trois mois renouvelables une fois [CPC, art. 129-2]).
• Indication par le juge de la date à laquelle l’affaire sera rappelée.
• Possibilité pour le juge d’écarter la délégation et de procéder lui même à la conciliation. La délégation à un conciliateur de justice n’est qu’une faculté.
2 – Conciliation en cours d’instance
5 En cas d’échec de la tentative préalable de conciliation, le juge d’instance peut à nouveau tenter de concilier les parties au cours de l’instance (CPC, art. 845, al. 2).
Si les parties se concilient en cours d’instance, le juge constate leur accord.
II – Préparation
A – Informations préalables
6 Attirer l’attention du client sur l’intérêt de procéder à la conciliation afin de résoudre rapidement le conflit à un stade non contentieux.
B – Contrôles préalables
7 S’assurer :
– de l’intérêt et de la qualité à agir du client ;
– que le litige relève de la compétence, matérielle et territoriale, du tribunal d’instance ;
– que le client dispose de toutes les pièces nécessaires ;
– que les délais pour agir ne sont pas expirés.
C – Pièces nécessaires
8 Fournir l’intégralité des pièces à l’appui de la procédure.
D – Coût de la procédure
9 La procédure de conciliation est gratuite. Le timbre fiscal, d’un montant de 35 €, mis à la charge des justiciables pour engager une action en justice a été supprimé par un décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013.
Honoraires d’avocat en cas de représentation par un avocat (fixés librement). Attention, depuis la loi dite « Macron » du 8 août 2015, la convention d’honoraires doit obligatoirement être écrite.
Un droit de plaidoirie, collecté auprès du client, est dû par l’avocat pour chaque plaidoirie ou représentation à une audience de jugement. Le montant du droit de plaidoirie est de 13 €. Les droits de plaidoirie doivent être payés chaque trimestre à la Caisse nationale des barreaux de France.
III – Procédure
A – Assistance et représentation
10 Devant le conciliateur, les parties peuvent se faire assister ou représenter par (CPC, art. 828) :
– un avocat ;
– un conjoint ;
– un parent ou allié en ligne directe ;
– un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
– un concubin ;
– une personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
– une personne exclusivement attachée à leur service personnel ou à leur entreprise.
B – Matières
11 Gracieuse.
La conciliation est un mode alternatif de résolution des conflits.
Guide du jeune avocat 2017
Auteurs : Sous la direction d’Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de Paris, et la coordination de Lucile BERTIER, avocat au barreau de Paris.
Collectif LexisNexis




