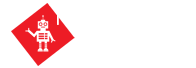ZOOM. – À mi-chemin entre la science et la technique, la médecine illustre un savoir-faire créatif, au cœur duquel l’innovation prend tout son sens. D’un cadre expérimental, d’abord, à une application clinique, ensuite, les avancées médicales s’affranchissent des mystères de la science et révolutionnent ainsi le domaine de la santé. Un chemin décrypté aujourd’hui sous l’angle de deux nouvelles stratégies de soins, la première dans la discipline des greffes, la seconde dans le domaine de la santé connectée.
Si Oscar Wilde écrivait « le progrès n’est que l’accomplissement des utopies », force est de reconnaître, qu’appliqué à la sphère médicale, il incarne un idéal et stimule les rêves de chercheurs passionnés. Promouvoir l’accès aux technologies dans le domaine de la santé, telle est l’inclination irrésistible de ces hommes et de ces femmes engagés au service de la prévention, du diagnostic et de la thérapeutique.
La greffe ou le défi d’une médecine individualisée
Dans la course aux essais cliniques concluants, l’année écoulée signe de belles avancées parmi lesquelles la première transplantation mondiale de cellules cardiaques dérivées de cellules souches embryonnaires humaines, ainsi que la faisabilité d’une transplantation utérine à partir d’une donneuse vivante.
L’embryon, nouvel allié du cœur
Les 25e Journées européennes de la Société française de cardiologie, organisées à Paris du 14 au 17 janvier 2015, ont été l’occasion pour Philippe Menasché de présenter les résultats prometteurs de la thérapie cellulaire de l’insuffisance cardiaque. Le 21 octobre 2014, le chirurgien et son équipe de chirurgie cardio-vasculaire de l’hôpital européen Georges Pompidou ont effectué une greffe de cellules cardiaques dérivées de cellules souches embryonnaires humaines pour régénérer la lésion du cœur de la victime d’un infarctus. Particulièrement convoitées pour leur essence indifférenciée, les cellules souches embryonnaires sont dites « pluripotentes » en ce qu’elles sont capables de générer tous les types de cellules de l’organisme, à l’exclusion du placenta et des annexes. Le professeur Menasché reconnaît que le choix de l’utilisation de ces cellules est « purement pragmatique », motivé par la seule volonté d’obtenir des cellules cardiaques à partir de cellules pluripotentes. Prélevées, cultivées et spécialisées, les cellules ont été incluses dans un « biomatériau » chargé de garantir l’effectivité du bénéfice des cellules sur l’organe endommagé.
Un pansement cellulaire comme thérapie – Si la combinaison de cellules avec des biomatériaux était utilisée en orthopédie, il n’en demeure pas moins que le caractère innovant de la transplantation repose sur la spécialisation de cellules souches embryonnaires humaines en cellules cardiaques, une technique aujourd’hui brevetée. Vingt ans de recherche avec, pour point de départ, l’importation d’une lignée cellulaire (sur les conditions d’importation des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, V. CSP, art. R. 2151-13 et suivants). Depuis, la règlementation juridique relative au périmètre de la recherche biomédicale a évolué (V. JCP G 2015, 212, J.-R. Binet).
Un cadre légal libéral – Rappelons que la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 a substitué au régime d’interdiction de la recherche embryonnaire et à ses dérogations, un régime d’autorisation encadrée. L’article L. 2151-5 du Code de la santé publique précise qu’ « aucune recherche sur l’embryon humain, ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation ». Cette autorisation, délivrée par l’Agence de la biomédecine, veille à contrôler la pertinence scientifique du protocole de recherche, la finalité médicale et le respect des principes éthiques (CSP, art. R. 2151-1). Un esprit de libéralisation, insufflé par le législateur, sous l’impulsion du politique, auquel le professeur Menasché adhère. « Le régime actuel est une réelle satisfaction, non pas parce qu’il me permet de mieux travailler, mais parce qu’il lève une hypocrisie légale ».
Science et éthique, de faux amis ? – Un dilemme éthique demeure lorsqu’il s’agit de concilier les impératifs de la science avec le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, lui-même garanti par l’article 16 du Code civil. Partant d’une réalité selon laquelle le prélèvement des cellules souches embryonnaires induit inévitablement la destruction de l’embryon, la communauté scientifique s’interroge sur l’opportunité du projet, dont l’avenir dépend des choix éthiques que la société est prête à assumer. Pour Philippe Menasché, le questionnement éthique n’a pas lieu d’être dans la mesure où la recherche est menée sur des embryons « surnuméraires », conçus dans le cadre d’une procréation médicalement assistée, puis délaissés de tout projet parental et voués à la destruction, passé un délai de congélation de cinq ans (CSP, art. L. 2141-4). « Le problème serait tout autre si l’embryon était créé, volontairement et exclusivement, à des fins scientifiques pour produire des lignées cellulaires ». Or, à ce jour, la loi interdit qu’un embryon humain puisse être conçu à des fins commerciales ou industrielles (CSP, art. L. 2141-8).
Spécialisation, rajeunissement : une voie à privilégier ? – Une alternative à la recherche embryonnaire est sous le feu des projecteurs depuis la découverte, par une équipe japonaise, d’une nouvelle voie thérapeutique pour la médecine régénérative. Transformer une cellule souche adulte spécialisée en une cellule immature, telle est la prouesse scientifique du chercheur Yamanaka, récompensé par le prix Nobel de médecine, en 2012, pour la réussite de ce rajeunissement cellulaire.
La « cure de jouvence » – Une « recette de cuisine génétique » permet de faire régresser une cellule adulte en une cellule souche se comportant comme une cellule embryonnaire. Une similitude entre ces cellules pluripotentes induites (IPS) et les cellules souches embryonnaires (ES) pas « si évidente », pour le professeur Menasché. « On ne peut pas sous-estimer les problèmes sécuritaires liés à la reprogrammation du produit de thérapie cellulaire ».
Rêve de chercheurs – Si cette transplantation répond, par essence, à l’esquisse d’une innovation médicale, elle n’en demeure pas moins qu’une « étape » dans le traitement de l’insuffisance cardiaque. « Franchir le pas, pour générer de nouvelles initiatives », tel était le souhait de l’équipe de chirurgie cardiaque de Georges Pompidou, qui rêve désormais d’avenir. « S’il s’avérait in fine que le bénéfice attendu provient d’une combinaison de facteurs, libérés par les cellules greffées, alors on peut imaginer une thérapie cellulaire fondée sur une solution injectable, laquelle pourrait être raisonnablement pensée en termes de production industrielle, à supposer toutefois que l’industrie pharmaceutique s’intéresse au procédé ». Un vœu à exaucer, pour une médecine de demain toujours plus personnalisée.
Devenir mère après une greffe d’utérus
Le 4 octobre 2014, une suédoise donnait naissance à un enfant après avoir subi une greffe d’utérus. Une première mondiale, saluée en médecine procréative, aussi bien pour la faisabilité de la transplantation de l’utérus d’une donneuse vivante, même ménopausée, que pour la promesse de son indication thérapeutique. Grâce à la fécondation in vitro des ovules de la jeune femme, l’équipe médicale a obtenu et congelé des embryons. L’un d’entre eux a été implanté, un an après la transplantation de l’utérus, lequel provenait d’une femme plus âgée issue de son cercle familial.
Pouvoir sur le corps ou prouesse du corps ? – Cette grossesse signe une avancée réelle dans le traitement de l’infertilité utérine et ouvre un nouvel espoir de maternité. Car, si le nombre de femmes nées sans utérus est faible, une pour 5 000 environ, pourront être candidates à la transplantation, celles dont l’utérus a été enlevé ou n’est plus fonctionnel à cause d’un cancer ou d’une hémorragie consécutive à un accouchement. Une application clinique d’autant plus séduisante qu’elle pourrait éviter une maternité de substitution éthiquement contestée et juridiquement condamnée (sur la nullité de la convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, V. C. civ., art. 16-7). Réel espoir pour les femmes privées de la capacité de porter un enfant, la transplantation utérine ne peut constituer une alternative suffisamment dissuasive face à la tentation des mères porteuses, notamment pour les hommes. « Seule la perspective, plutôt effrayante, de la greffe d’utérus sur un homme, pour lui permettre de porter un enfant » pourrait, selon Aude Mirkovic, maître de conférences à l’université d’Évry, estomper le tourisme procréatif en ce que les commanditaires ne seraient plus obligés de franchir des frontières, des mers et des océans pour bénéficier d’une aide ailleurs légalisée. Or, « de façon prospective, une telle greffe reviendrait à anéantir le concept de maternité ».
Les vertus de la jeunesse – Pour autant, ce profil féminin ne dispense pas le médecin d’une consultation préalable, destinée à apprécier l’opportunité du projet parental. Pour Pascal Piver, directeur du centre d’assistance médicale à la procréation au CHU de Limoges, l’indication médicale de la greffe d’utérus ne doit concerner que les femmes en âge de procréer. « Pour un stade encore expérimental en France, la limite d’âge est fixée à trente-cinq ans, car après il y a une baisse de la fertilité ». De manière plus générale, l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique exige, pour mettre en œuvre une technique d’assistance médicale à la procréation, que « l’homme et la femme formant le couple, soient vivants et en âge de procréer ».
La loi encadre aussi l’autonomie de la volonté en matière de don d’organes, surtout lorsque le donneur est vivant (sur le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain, V. CSP, art. L. 1211-1 et suivants). Aude Mirkovic rappelle que « l’indisponibilité du corps humain interdit à la personne de disposer de son corps d’une manière qui présente un risque grave pour sa santé ou a fortiori met sa vie en danger, quand bien même ce serait pour aider autrui ». Ce principe trouve son fondement dans l’article 1128 du Code civil qui énonce que seules les choses qui sont dans le commerce peuvent être l’objet de conventions. En Suède, la patiente a bénéficié d’un don d’organe d’une amie, mais la greffe de mère à fille est souvent privilégiée pour limiter le risque de rejet de l’organe transplanté. En France, deux équipes s’inscrivent dans ce sillon, l’une à Limoges qui effectue des travaux à partir de donneuses décédées, l’autre à Suresnes qui conduit un projet de recherche sur des donneuses vivantes. Dans les deux cas, l’utérus est soumis aux règles juridiques applicables au don d’organes, à savoir la gratuité (CSP, art. L. 1211-4), le consentement (CSP, art. L. 1211-2) et la nécessité thérapeutique (sur la dérogation à l’anonymat, V. CSP, art. L. 1211-5). Et ce, quelle que soit sa singularité.
Une chirurgie légitime ? – Alexandra Henrion-Caude, directrice de recherche à l’Inserm à l’hôpital Necker, souligne « la particularité de ce type de greffe en ce qu’elle n’est pas vitale pour la patiente et reste techniquement compliquée. La candidate à la transplantation le fait pour pouvoir être enceinte, ce qui l’expose non seulement aux complications inhérentes à la transplantation d’un utérus mais aussi aux risques de toute grossesse ». Une réserve partagée par Aude Mirkovic lorsqu’elle met en balance la finalité médicale de la chirurgie avec ses enjeux financiers. S’il est encore tôt pour évaluer le montant d’une greffe d’utérus, « est-il juste et équitable, dans un contexte où ni la vie, ni la santé de la femme ne sont directement en jeu, qu’une telle dépense soit prise en charge alors que de nombreux soins ne le sont pas, faute de moyens » ? Une question aujourd’hui sans réponse, mais un fil conducteur pour repenser l’offre de soins.
À l’heure où la médecine met au défi le corps humain de donner le maximum de ses capacités pour améliorer ses fonctionnalités, depuis le stade embryonnaire jusqu’à l’âge adulte, celle-ci semble paradoxalement se reposer sur l’objet et les nouvelles technologies pour traiter ce même corps.
La e-santé et la question d’une médecine déshumanisée
Folie innovante
Magique ! Pillcam* sonne la fin de l’endoscopie ! Cette gélule à ingérer contient une minuscule caméra vidéo et une source lumineuse pour éclairer l’intérieur de l’intestin. Une fois avalée, la vidéocapsule parcourt les kilomètres d’intestin grêle que rien jusqu’à maintenant ne permettait d’explorer en son entier ! Elle capte des images vidéo et les transmet à un enregistreur externe que le patient porte à la ceinture !
Pill’up* vous garantit, quant à elle, une prise de médicaments sans faute ! Ce dispositif, présenté sous la forme d’un bouton, se colle sur la boîte de médicaments. Il s’allume à la bonne heure et s’éteint lorsque l’on appuie dessus, après la prise du médicament. Il suffit au préalable d’indiquer à l’application (iOS et Android) l’heure et la fréquence de prise du traitement pour qu’elle puisse donner l’alerte en temps voulu. Le bouton possède une mémoire interne qui retient l’information. Dès que votre smartphone se trouve près du bouton, les deux se synchronisent.
Imedipac*, lui, est carrément un pilulier connecté qui indique à son utilisateur quand et quel médicament il doit prendre jour après jour. Une fois programmé, il est capable d’envoyer un sms et/ou un mail à l’utilisateur pour lui rappeler la prise de son médicament et une diode électroluminescente (LED) clignote pour indiquer quelle alvéole le patient doit ouvrir. En cas d’oubli de prise, un SMS est envoyé au médecin ou à la famille pour les avertir que la personne malade n’a pas suivi son traitement.
Dans un autre genre, la brosse à dent Smartseries* nous laisse aussi pantois ! Grâce à son application, elle analyse les performances bucco-dentaires de son utilisateur, conseille et propose un brossage personnalisé et ne manque pas de distraire l’utilisateur lors de ce brossage routinier avec la météo et les informations… Les données de l’application permettent de tirer des conclusions du comportement d’hygiène buco-dentaire des utilisateurs.
Comment TOUT savoir sur son sommeil ? Emfit* QS a relevé le défi ! Ce moniteur de santé, caché sous le matelas et connecté via un réseau Wi-Fi, enregistre sur la web application nos comportements nocturnes et analyse rythmes respiratoire, cardiaque et mouvements, pour indiquer le style de sommeil de l’utilisateur.
Rejiva va plus loin encore. Collé sur la poitrine comme un patch, il peut calculer électrocardiographie, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, qualité du sommeil, niveau d’énergie, état du système nerveux autonome, stress et dresser un véritable bilan de santé. Les informations collectées sont envoyées en temps réel au smartphone du porteur via une application. Cet objet médical se transforme aussi en coach et propose des exercices simples et des conseils à suivre pour améliorer son état de santé.
Les diverses balances connectées calculant la masse graisseuse, hydrique, osseuse et musculaire ne nous étonnent plus. Se développent désormais le collier connecté qui avertit l’utilisateur lorsque celui-ci adopte une mauvaise posture (Fineck) ou encore la ceinture connectée (Lumoback) qui enregistre tous les mouvements et vibre lorsque celui qui la porte adopte une mauvaise position. Elle permet également de suivre en temps réel sur le smartphone, le temps passé debout, assis, le nombre de pas etc. Que dire des applications dédiées aux patients souffrant de la sclérose en plaque (Sam Sep) ou faisant l’objet d’un traitement en chimiothérapie (ichemo diary*)… Google nous étonne encore avec la dernière piste qu’il explore pour détecter les cellules cancéreuses circulant dans le corps, grâce à un bracelet équipé d’un aimant à nanoparticules. Des pilules contenant des nanoparticules devront être ingérées. Ces dernières, après avoir trouvé les cellules cancéreuses, s’y agrippent et les illuminent. Ainsi, il devient possible de voir à travers la peau si le corps contient des cellules cancéreuses.
Si certaines applications sont destinées à faciliter la vie du malade et à le rendre autonome, d’autres, destinées au grand public, prodiguent des conseils pour une santé toujours meilleure, tandis que certaines sont consacrées aux professionnels de la santé (applications qui permettent de consulter des radiographies ou reconstituer en 3D des organes depuis une tablette tactile par exemple). Ces derniers voient en effet leurs pratiques bouleversées : consultations à distance, acte chirurgical à distance, non, ce n’est pas de la science-fiction ! Enfin, un mot en filigrane sur la notion de Big Data qui semble investir également le monde médical. Cette masse de données peut s’avérer riche d’enseignements pour les professionnels qui pourraient y puiser des informations précieuses pour améliorer la santé et mieux cibler les pathologies.
Mais derrière toutes ces illustrations se profilent de nombreux termes Télésanté, e-santé, Télémédecine, santé-mobile, santé connectée, une véritable nébuleuse que Maître Caroline Zorn se propose de définir et d’expliquer pour mieux comprendre les enjeux de ces innovations.
Nébuleuse de termes
« Il est important de revenir aux basiques, même si c’est moins glamour, et de poser des termes juridiques partagés dans l’Union européenne sur des questions qui valent la peine d’être envisagées avec sérieux » nous dit Maître Caroline Zorn. Le terme télémédecine est défini à l’article L. 6316-1 du Code de la santé publique : « La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient ». Le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine détaille les quatre branches officielles de la télémédecine, laquelle ne peut être accomplie que par le médecin : la téléconsultation qui permet à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient, la téléexpertise par laquelle un professionnel médical sollicite à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux, la télésurveillance médicale permettant d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et enfin, la téléassistance médicale par laquelle un professionnel de santé peut assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte. (CSP, art. R. 6316-1).
La télémédecine est donc une « possibilité nouvelle d’exercice de la médecine », à différencier de la télésanté qui va bien au-delà puisqu’elle « recouvre les activités de santé des professionnels du soin par voie électronique ». Ces activités sont à entendre au sens large (suivis médicaux, messageries sécurisées, etc.).
Le terme e-santé est plus large encore que la télésanté qui est propre à l’activité des professionnels, puisqu’elle a été décrite en 2009 par la Commissaire européenne à la santé, Androulla Vassiliou, comme l’ensemble des « différentes applications des technologies de l’information et de la communication aux soins de santé ». La e-santé englobe les applications santé pour smartphones ou tablettes et les objets intelligents (ceinture, bracelet ou tensiomètre personnels), tous ces terminaux de santé électroniques qui permettent de recueillir les données des patients et se situent tant au niveau des professionnels que des particuliers. Dans cette e-santé, le terme de santé mobile, en vogue actuellement, insiste sur la place du smartphone et de la tablette par rapport aux données de santé : ce sont « les pratiques médicales et de santé publique reposant sur des dispositifs mobiles tels que téléphones portables, systèmes de surveillance des patients, assistants numériques personnels et autres appareils sans fil »[1].
Enfin, Maître Caroline Zorn lie les termes de santé connectée et santé mobile qui, de fait, renvoient à la même notion. La santé connectée induit des échanges entre des objets connectés et un hébergement de données. Un mobile étant connecté, ces deux notions se recoupent. La santé connectée reste un « détail » et cette expression est sans importance en termes de cadre juridique ou même d’innovation.
Mais quel est le cadre juridique existant pour l’e-santé ? Y-a-t-il un droit de la santé électronique ?
Qui a dit vide juridique ?!
Maître Caroline Zorn nous rappelle que si l’activité de télémédecine est la seule à être décrite par la loi, toutes les solutions de télémédecine et de santé électronique reposent sur les mêmes principes, à savoir des recueils de données, des traitements de données, un hébergement, un partage de données entre professionnels ou particuliers, auxquels s’ajoutent des notions de commerce électronique, de dispositifs médicaux, de logiciel, etc. Or, on ne peut pas parler de vide juridique dans ces domaines. Si la télémédecine a nécessité un détail réglementaire particulier, c’est « parce que ses actes ont vocation à être pris en charge par l’assurance maladie » ! Mais cela ne veut pas dire pour autant que toutes les autres solutions qui existent dans le domaine de la santé électronique ne sont pas encadrées juridiquement ! Ce cadre se construit à partir de textes généraux existants et non sur une loi spécifique. Interviennent ainsi le droit pénal pour le secret professionnel, le droit civil pour la confidentialité, le Code de la santé publique pour les droits du patient. La particularité, en l’espèce, relève de la nécessité de « balayer toutes les branches du droit et de les articuler entre elles pour faire du droit de la santé électronique ». La grande richesse de cette spécificité est que la généralité des règles juridiques qui s’appliquent permet de donner un cadre aux innovations sans cesse plus nombreuses tandis qu’une loi spécifique deviendrait vite obsolète au gré de ces nouveautés ! Le défi juridique majeur ici est en réalité la protection de la personne ! Cette personne qui installe des applications sur son smartphone et sa tablette et utilise une balance ou un tensiomètre intelligent … Quel meilleur outil de protection, si l’on sait le décliner, que l’intemporel article 9 du Code civil qui garantit à chacun le « droit au respect de sa vie privée » ? Maître Caroline Zorn insiste ensuite sur la clarté de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, suffisante pour encadrer le lancement de nouvelles applications ou objets connectés… même si la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) est débordée et devrait voir ses moyens renforcés. Mieux vaut donc rester sur ces grands principes et les adapter aux situations concrètes pour éviter l’obsolescence de règles spécifiques, véritable danger à l’heure où les innovations connaissent une croissance exponentielle et assurer ainsi l’efficacité du droit dans la durée. La spécificité doit, selon Maître Caroline Zorn, se trouver chez les acteurs du secteur tels la Cnil, les professionnels de la santé, les avocats et les magistrats – qui manquent parfois de connaissances en ce domaine – mais pas dans les textes ! Cela ne veut pas dire pour autant qu’aucune évolution législative n’est à prévoir. Maître Caroline Zorn fait référence notamment à l’explosion, ces dernières années, des modifications apportées au texte relatif au partage des données de santé et aux droits des patients dans le Code de la santé publique, lesquelles modifications n’ont pas toujours été bien rédigées. Ainsi, l’article L. 1111-8 du Code de la santé publique a été modifié plus de dix fois en dix ans et parfois de manière insatisfaisante. La loi dite de « modernisation du système de santé » a été votée le 14 avril 2015 et modifie encore la question de la gestion des données de santé entre professionnels. Notamment, le texte élargit l’obligation de recourir à un hébergement agréé des données de santé (CSP, art. L. 1111-8, al. 1er), et celle de respecter les référentiels de sécurité et d’interopérabilité (RGS et RGI) pour tout échange de données de santé par voie électronique (CSP, art. L. 110-4). De plus, la nouvelle loi Santé facilite le partage des données du patient pris en charge. Les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions étant fixées par décret, peu de choses sont aujourd’hui figées d’où « une insécurité juridique certaine ». Quoi qu’il en soit, la loi se situe davantage sur le terrain de la télésanté et de la télémédecine.
Les défis du juriste
Selon Maître Caroline Zorn, deux défis principaux sont à relever pour le juriste :
La créativité juridique : pour accompagner à bien des projets toujours plus innovants.
Être un fin juriste : l’informatique a des années lumières d’avance sur le droit, il n’est donc pas possible pour le législateur de s’adapter. C’est donc au juriste d’avoir une parfaite connaissance de l’arsenal juridique existant et donc des outils dont il dispose pour ensuite les mettre en œuvre au service des projets innovants et prévoir ainsi les risques qui peuvent se poser. Si Internet est source de dangers infinis, il est aussi source de potentialités infinies !
Dangers et valeurs menacées.
Pourquoi s’inquiéter ? – D’après Maître Zorn, si les valeurs menacées par un développement anarchique de ces innovations santé sont effectivement le droit de la personne à l’oubli et à la vie privée, le respect des normes techniques édictées par les autorités administratives indépendantes comme le Référentiel général de sécurité (RGS), l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIPSanté), ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), est la garantie de ces grands principes. L’accompagnement des acteurs dans le développement de ces projets innovants suffit donc à passer outre ces dangers.
Alors pourquoi s’inquiéter de l’informatisation de la médecine, de ces nouveaux échanges entre médecins ou entre médecins et patients via la télémédecine, de l’utilisation des données transmises par les objets connectés impliquant une meilleure connaissance des patients par leur médecin, de la richesse d’informations contenues dans le Big Data permettant aux professionnels de tirer des enseignements des techniques et médicaments déjà utilisés dans des cas similaires à ceux auxquels ils sont confrontés ? Les professionnels de santé sont ainsi conduits à cibler avec plus de précision les besoins de leurs patients et peuvent, par conséquent, adapter davantage les traitements aux personnes, en fonction des risques et cas rapportés par des confrères. Ce partage d’expérience enrichit les connaissances de chacun et permet une meilleure utilisation des soins existants. Enfin, les objets connectés et les applications mobiles ouvrent la voie à une médecine préventive. Prévenir plutôt que guérir, telle est la devise de l’e-santé!
Quid de la personne ? – Et pourtant, ces inquiétudes ne peuvent nous laisser indifférents tant les enjeux en cause sont considérables. Il s’agit de la personne et c’est bien elle qui est au cœur des préoccupations. Les normes techniques imposées semblent largement dépassées par la réalité. La collecte massive de données, leur stockage n’assurent pas une confidentialité absolue et celui qui livre les informations n’a pas une connaissance éclairée de leurs utilisations et des effets d’un tel dépouillement. Les secrets d’Internet nous dépassent largement ; qui peut prétendre maîtriser le flux de ces informations dans un monde virtuel transfrontalier ? Outre le problème lancinant de la protection des données personnelles, auquel peut être rattaché celui du secret professionnel, se pose celui de la protection de la vie privée, intimement lié au premier. Ces nouvelles applications santé et ces objets connectés sont très intrusifs, ils épient les habitudes de leurs utilisateurs pour en tirer des conclusions catégoriques et renvoient ces données à un terminal. Ils s’introduisent dans la vie de la personne pour lui dicter sa conduite, tel un vrai coach numérique. Le numérique peut-il ainsi se permettre de guider la personne, cet être complexe et unique construit par son expérience personnelle ? Aux sixièmes assises des technologies numériques de santé, Olivier Peyret, adjoint à la directrice du Laboratoire d’Électronique et de Technologies de l’Information (LETI) donnait l’exemple de cet objet connecté chargé de détecter les crises d’épilepsie en nocturne, lequel a révélé le manque de fiabilité du capteur, diagnostiquant des crises d’épilepsie qui n’en n’étaient pas à partir de signes extérieurs qui, en réalité, varient d’un patient à l’autre. « On peut modéliser un smartphone mais pas le patient ! » s’écriait ce professionnel. Avec l’explosion du numérique, n’y a-t-il pas un risque de ne plus s’intéresser à la personne en elle-même mais de créer des catégories : tel symptôme sera immédiatement interprété par l’objet comme étant le signe de telle maladie ; en cherchant dans les bases de données immenses des cas similaires, le médecin aura tendance à rechercher des modèles à suivre et à créer des cas types.
Jean-Claude Lapraz, médecin clinicien, déplorait à ces mêmes assises notre système de santé « qui prend en compte la maladie mais a laissé de côté en grande partie dans son approche le malade » avant de réclamer la nécessité de « remettre le malade au centre du système », de « replacer la maladie dans le malade » et de mettre l’accent sur ce dialogue médecin/malade qui est essentiel. La question qu’il faut se poser face à un malade est alors la suivante : « quelle signification ce symptôme a par rapport à la façon dont le métabolisme que vous avez en face de vous se gère ? » Le développement du numérique en santé ne va-t-il pas renforcer cette tendance ?
La médecine, art ou science ? – En effet, la médecine tend à devenir une médecine de masse, un ensemble de cases dans lesquelles doivent entrer les patients indépendamment de leur identité propre , biologique, psychologique etc. La maladie semble être diagnostiquée et traitée indépendamment de la personne malade elle-même. L’art du diagnostic, ce secret patient/médecin s’évanouit au détriment de l’individu qui se trouve mis de côté, au bénéfice de prouesses techniques et technologiques toujours plus époustouflantes. La dextérité du chirurgien liée à son talent personnel s’efface avec la téléassistance médicale qui permet au professionnel réputé d’assister à distance, virtuellement, un autre médecin lors d’une opération. La médecine se résume-t-elle à une science, une connaissance intellectuelle, technique voire mathématique, un savoir transmissible virtuellement, ou se situe-t-elle dans le domaine de l’art où le talent de chacun importe autant que les techniques utilisées ?
Prospective – Maître Caroline Zorn nous confie que si l’heure est aujourd’hui aux objets connectés, il est fort probable que sur le chemin des NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives), nous parvenions demain à mettre en place un corps connecté qui livrera en permanence ses secrets, sans intermédiaire, grâce à des capteurs implantés. Constamment connecté, le corps transmettra des données intimes et personnelles, directement à la machine qui les traitera. Qu’en deviendra-t-il de la notion de vie privée ? L’homme se transformera-t-il en être téléguidé ?
Conclusion – Prise dans le tourbillon de l’innovation, la médecine semble elle aussi époustoufler par les prouesses qu’elle réalise tant à partir du corps humain, matière première précieuse pour combler les lacunes dont celui-ci peut souffrir, qu’à partir de nouvelles technologies sans cesse plus intelligentes qui tendent à diriger l’homme, voire à se substituer à lui lorsque l’objet remplace le médecin. L’humain au service du corps, d’une part, et la déshumanisation de la médecine et du corps, d’autre part, véritable antithèse qui nous mène à nous questionner sur les bienfaits de l’innovation médicale : ce pari scientifique n’est-il pas synonyme de défis juridique et humain ?
Article rédigé par Anne-Louise Grout de Beaufort et Alice Philippot
Sources : Monsieur Philippe Menasché, professeur des Universités, chirurgien des hôpitaux, Madame Aude Mirkovic, maître de conférences à l’Université d’Évry et Maître Caroline Zorn, avocat, docteur en droit et chargé d’enseignement à l’Université de Strasbourg.
[1] Organisation mondiale de la santé, mHealth – New horizons for health through mobile technologies, Global Observatory for eHealth series – Volume 3, p. 6).
* Marques déposées à l’INPI.